Joëlle Zask - Quand la forêt brûle
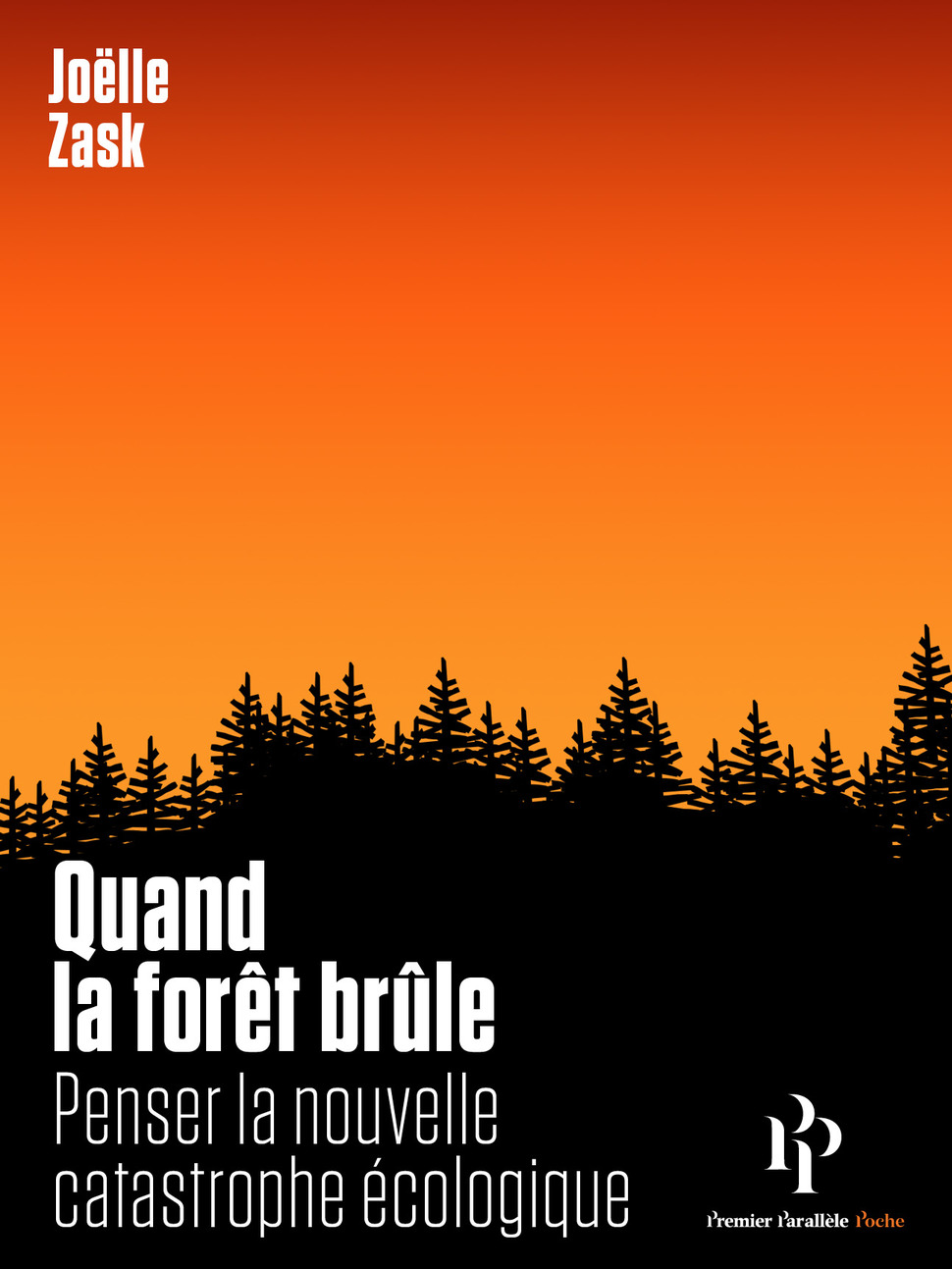
« Le phénomène des mégafeux agit comme un révélateur de notre rapport à la nature. »
Quand la forêt brûle Penser la nouvelle catastrophe écologique
Ce livre est disponible en librairie au prix de 9.90 €
Acheter le livre en numérique au prix de 11.99 €:

Quand la forêt brûle Penser la nouvelle catastrophe écologique

Vous pouvez acheter des livres en format epub ou mobi sur notre site. C'est aussi une manière de soutenir notre développement.

Quand la forêt brûle Penser la nouvelle catastrophe écologique

Vous pouvez lire nos livres directement sur écran, sur notre site. C'est aussi une manière de soutenir notre développement.

Quand la forêt brûle Penser la nouvelle catastrophe écologique

Vous pouvez commander le livre papier en ligne, sur le site de la FNAC. Il vous sera expédié chez vous.

Quand la forêt brûle Penser la nouvelle catastrophe écologique

Si vous avez une liseuse Kindle, vous pouvez acheter ce livre sur Amazon.

Quand la forêt brûle Penser la nouvelle catastrophe écologique

Phasellus malesuada rutrum risus, eu tortor malesuada quis. Proin feugiat consequat nisi, nec mollis nunc consequat vitae.

Quand la forêt brûle Penser la nouvelle catastrophe écologique

Vous pouvez acheter nos livres en ligne, sur le site du libraire bordelais, Mollat.
Nos livres numériques sont disponibles dans tous les formats.
Nous vous les proposons sans DRM, c'est-à-dire que vous pouvez les lire sur autant de supports que vous le souhaitez si vous les achetez directement sur notre site.
Merci de respecter le droit de propriété et de ne pas les diffuser sans autorisation.
Acheter nos livres sur notre site
Vous pouvez acheter nos livres directement sur notre site, sous deux formats :
Lire en ligne (sur l'écran de votre ordinateur)
Vous pouvez lire en ligne (« en streaming ») en vous créant un compte à la rubrique « se connecter » : vous retrouverez votre bibliothèque personnelle chaque fois que vous vous connecterez sur Premier Parallèle.
Télécharger nos livres numériques (lisibles sur tous les supports)
En cliquant sur .epub / .mobi, vous pouvez télécharger directement nos livres (.mobi si vous avez une Kindle, .epub pour tout autre support) et les lire sur votre liseuse, votre tablette ou votre téléphone. Vous pouvez également les lire sur un ordinateur en téléchargeant Calibre ou Adobe Digital Edition.
Acheter nos livres numériques dans une librairie en ligne
Vous pouvez acheter nos livres sur les librairies en ligne pour les télécharger directement sur votre tablette, votre liseuse ou votre téléphone :
- Vous possédez une Kobo : vous pouvez télécharger nos livres sur le site de Kobo ou de la Fnac.
- Vous possédez un iPad ou un iPhone : vous pouvez télécharger nos livres sur iTunes
- Vous possédez un Kindle : vous pouvez télécharger nos livres sur Amazon.
- Vous possédez un terminal Samsung : GooglePlay a ce qu'il vous faut.
- Vous possédez tout autre terminal de lecture : rendez-vous sur epagine.fr
Des questions ?
Vous trouvez tout cela compliqué? Ecrivez-nous, nous vous répondrons très vite.
×Les feux de forêt ont pris depuis quelques années une ampleur inédite : nous avons désormais affaire, un peu partout dans le monde, à des mégafeux. Ils sont extraordinairement destructeurs et nul ne parvient à les arrêter.
Symptôme spectaculaire du réchauffement climatique qu’ils contribuent à accélérer, ces mégafeux révèlent une société malade, qui a choisi de délaisser des usages traditionnels du feu au profit d’une approche techniciste et dominatrice – pendant d’un discours sur une nature idéalisée, à laquelle il ne faudrait pas toucher.
Quand la forêt brûle, véritable enquête philosophique, dessine les contours de ce nouveau fléau et nous aide à repenser nos relations avec la nature, qui n’est jamais que le résultat des soins que nous lui prodiguons.
« Passionnant. »
Augustin Trapenard, France Inter
« J’ai énormément d'admiration pour Joëlle Zask. »
Erik Orsenna
« C’est vraiment passionnant. »
C Politique, France 5
« Le résultat est saisissant, ose-t-on dire… glaçant ? »
Catherine Portevin, Philosophie Magazine
« À lire Joëlle Zask, on comprend que le phénomène terrifiant des mégafeux rend le rêve d'une maîtrise totale des espaces naturels par la raison instrumentale aussi farfelu que le fameux "lâcher prise". » Sébastien Lapaque, Le Point
« Le livre de Joëlle Zask a l’immense mérite d’inviter ses lecteur·ice·s à penser la globalité et la matérialité des mégafeux. »
Mediapart
« Il faut le dire, c'est l'un des grands livres de l'année. »
Alexis Lacroix, France Culture
« Ce petit livre brillant agit comme un électrochoc salutaire. »
UP' Magazine
« Un ouvrage d'une actualité brûlante qui fait froid dans le dos... »
Coup de cœur des Libraires ensemble

Premier Parallèle
Retrouvez-nous sur