Une lune presque pleine éclaire mon corps en vrac au pied d’une falaise. Face contre terre, mes chairs incrustées dans un éboulis en pente. Presque toute l’histoire qui va suivre est en pente. Cinq jours, seul, sans eau, en pente. Nous sommes le samedi 15 juin 2019, il est 21 heures. Les pierres légères et coupantes, grêlées de fossiles marins rugueux, roulent sous les parties encore mobiles de mon corps. Sur ce tapis de fakir minéral, ma position devrait être inconfortable. Pourtant, je ne ressens rien de plus, au contact du sol, que quelques longues griffures qui semblent m’ancrer solidement aux reliefs de la roche. Ainsi fixé, enfiché, je ne fais plus qu’un avec cet épais flanc de montagne, gris, blanc, brun et rouge qui, jadis horizontal, constituait un fond marin couvert de corail.J’ai chuté d’environ sept mètres, peut-être plus, du haut d’un versant qui en compte plus de quarante. Mon corps a ensuite frappé une roche pour être stoppé net par la rugosité de la paroi qui perdait là, un court instant, sa verticalité. Affalé sur mon flanc droit, ramassé, froissé, déchiré, n’offrant aucun profil qui pourrait indiquer la présence d’une silhouette humaine, je me fais l’effet d’un vieux tee-shirt lourd de sueur, jeté là et oublié.
J’ouvre l’œil gauche. Il me semble ne plus savoir comment ouvrir l’œil droit. Ou bien la communication est coupée.Comme tout le reste de mon corps, profondément endormi, mon bras droit ignore mes demandes de mouvement. Seul mon bras gauche parvient à bouger. Il se lance, hagard, sans forces, dans une lente exploration tactile, à la recherche des membres rescapés. Sous la peau de mon avant-bras droit, je trouve un second coude aussi pointu que désarticulé. C’est un étrange et nouveau relief de fragments d’os poussant sous la chair qui se présente à la pulpe de mes doigts. Plus bas, ma mâchoire est posée sur mon biceps écrasé. Malgré la douceur de la nuit tropicale, mon menton et ma barbe sont glacés et trempés. Assommé, sans certitude d’être véritablement éveillé, je tente de résoudre les questions dans l’ordre où elles se présentent. Quelle peut être la nature du liquide qui a mouillé mon visage ?Bien qu’en pareilles circonstances d’autres questions puissent paraître prioritaires, mon esprit tout entier s’attarde à résoudre ce petit mystère. Ça ne peut être l’eau de ma bouteille, dont j’ai bu, inquiet, les dernières gouttes une ou deux heures avant la chute. Couché au sol, presque en boule, ai-je pu d’une façon ou d’une autre uriner sur mon visage ? Je tâte mon entrejambe et le haut de mes cuisses ; je suis totalement sec et habillé. L’enquête est épuisante, je fais une pause. Dans le calme et l’immobilité, les messages envoyés par mon corps se font entendre plus clairement. Mon côté gauche – jambe, hanche, fesse, côtes et épaule – est en proie non à la douleur mais à une pesanteur extrême, et refuse de bouger.
Je poursuis l’exploration du chantier et reviens ausculter le reste de ma tête. Arrivés à la tempe droite, mes doigts ont l’étrange surprise de trouver un membre nouveau, formant une très épaisse oreille de chien. Elle est longue et large comme la paume de ma main, épaisse comme un petit roman de cent cinquante pages et capable de ressentir mes palpations intriguées. Je pense aux oreilles de Pluto, le compagnon de Mickey Mouse. Ma main remonte encore le long de mon visage et tombe littéralement dans un trou. Sous mes doigts se présente, lisse, dur et glissant, mon crâne à nu. Premier mystère résolu. Pas de membre nouveau. Juste un morceau de ma joue, de ma tempe, de mon front et de mon cuir chevelu qui pend. Bien plus épais qu’attendu, cette grande pièce de chair sensible m’offre des sensations inconnues. Toucher ma peau et mes cheveux à un endroit où ils ne devraient pas être est surprenant. Caresser la face interne de ce lambeau tiède, humide et vivant, composé de muscles, de nerfs, de graisses et de tendons habituellement inaccessibles est plus que déroutant. Ces tissus d’ordinaire tendus autour du crâne sont – touchez votre cuir chevelu ! – relativement fins. Mais une fois « libres », ils se rétractent jusqu’à dépasser un centimètre d’épaisseur. »
Il m’est arrivé autrefois d’abattre et de dépecer des bêtes pour les manger – des poissons pêchés avec mon grand-père, des poules données par un voisin parti travailler à l’étranger, un mouton au Kirghizstan avec des amis qui préparaient l’Aïd. Le léger vertige que je ressentais en séparant la peau des chairs me revient. Observer de l’intérieur le support matériel de la vie, décharné, plus que nu, est une expérience dont le souvenir peine à s’adoucir avec le temps. Images, odeurs, matières, couleurs, textures conservent, au fil des années, une fascinante netteté. La complexité et la beauté des organes, les réseaux de nerfs, de veines et d’artères, le squelette et tous les tissus qui structurent les os entre eux révèlent la puissance élaborée, fragile et extraordinaire de l’évolution de la vie. Ouvrir, vider et nettoyer un animal donnent un accès privilégié, presque cabalistique, à la salle des machines. Admirer, sur une bête, la forme parfaite d’une rotule et l’agencement idéal de tous les composants qui l’entourent, c’est entrevoir comment la vie fonctionne, a su se construire et s’adapter aux conditions extérieures, a testé des variantes et émis des hypothèses. Me voilà aujourd’hui à mon tour dépecé, à la fois macchabée résigné et novice fébrile découvrant les entrailles du corps humain. La porte de la salle des machines s’est entrouverte.Je poursuis la visite médicale. Ma barbe et mon tee-shirt trempé sont imbibés, je le comprends clairement maintenant grâce à la lueur de la lune, de mon sang sombre qui coule encore. Mon œil droit est enfermé sous une paupière gonflée comme une petite pomme, chaude et ferme comme un muscle gorgé de sang, convoquant une fois de plus le mystère de la bosse et des hématomes qui enflent. Comment et pourquoi gonflent les blessures ? Quelles matières viennent s’agglutiner autour d’une contusion ? Il fait nuit, une nuit immense et, dans le plus grand calme, d’antiques questions s’invitent à cette étrange veillée. Malgré un état des lieux médical déplorable, rien ne paraît pour le moment plus urgent que de laisser mon esprit s’attarder sur les réactions de mon métabolisme face à ce morceau de falaise tropicale, rugueux et pentu. Je suis tout entier concentré, curieux et fasciné par la leçon donnée ce soir-là sur la petite estrade de pierre de mon amphithéâtre de fortune.Je termine l’inventaire des blessures et relève que talon droit et cheville droite ont doublé de volume.
La fatigue du côté gauche gagne maintenant l’ensemble du corps. De moins en moins attaché à mon rôle de blessé et à cet assemblage de membres affalés, j’accueille cette nouvelle donnée sans plus d’inquiétude. C’est donc ainsi que l’on meurt. Ce qui m’étonne, en revanche, c’est la simplicité de la chose. Juste une chute, pas de techniques compliquées, de trompettes, de systèmes mécaniques ; personne n’est impliqué, j’ai fait cela tout seul, sans rien, à la seule force de la gravité. Je pense maintenant à Newton et à sa pomme. Chacun la sienne.Naïvement, j’imaginais que la vie, ma vie, nécessitait plus qu’une simple dégringolade pour prendre fin. Moins de dix mètres de vide. Dix mètres de presque rien.Tomber et mourir me semblaient jusqu’ici impossible. J’ai tant grimpé. Arbres, monuments et parois rocheuses. J’ai tant marché, dévalé chemins, pierriers et lits de torrents. Mais je me rends compte du ridicule de cette pensée. Je ne serai évidemment pas le premier à périr de la sorte. Une chute mortelle, scène aussi funeste que banale depuis qu’Homo sapiens explore falaises, grottes et dénivelés.
Je me vide de mon sang. Impossible de joindre les secours, seules quelques rares zones de l’île sont reliées aux réseaux de téléphonie. J’appelle à l’aide en hurlant et écoute en retour le silence harmonieux d’une nuit de jungle. L’air se déplace et vibre autour de moi : mouvements enveloppants de fluides tièdes, odeurs sèches et minérales de silex frappés, de terres chauffées, chants de bêtes, d’oiseaux et d’insectes. L’écho lointain de mon hurlement emporte mes dernières inquiétudes. La montagne m’accueille, berce chacun de mes sens. Tout autour, c’est la jungle couronnée de grands pics minéraux. La gravité m’a incorporé à ce petit territoire qui, déjà, m’assimile en douceur. La fatigue me fait maintenant l’effet d’un courant marin démesurément plus fort que moi. Fort comme les baïnes, ces courants des côtes atlantiques dont on ne peut espérer sortir qu’en acceptant de se laisser porter en nageant parallèlement à la plage jusqu’à rejoindre la terre ferme, parfois plusieurs centaines de mètres plus loin.Je laisse la fatigue me submerger en pensant à mes enfants, qui n’auront plus de père. Je sais qu’ils ont des mères et des familles attentives, qu’ils grandiront couverts d’amour.Je suis triste.Dans le calme absolu de la nuit, loin de toute activité humaine, de ses nuisances technologiques, sonores ou lumineuses, apparaissent alors lentement, dans un petit halo de lumière douce qui flotte devant mes yeux, les visages de mes deux fils. Mes dernières pensées prennent littéralement forme devant moi. L’intensité du moment leur offre une matière palpable, imprimée sous mes yeux en une 3D lumineuse. Une douce et bienveillante incarnation holographique. Je profite de leurs regards curieux, pleins de la vie à venir.Les courants de fatigue se font encore plus forts. Mon corps entier est lourd, endolori par une gravité croissante et traversé de picotements. Il réclame l’extinction. Je me laisse glisser.
Voilà, fini, rideau, je m’endors, me dis-je, une fois pour toutes.
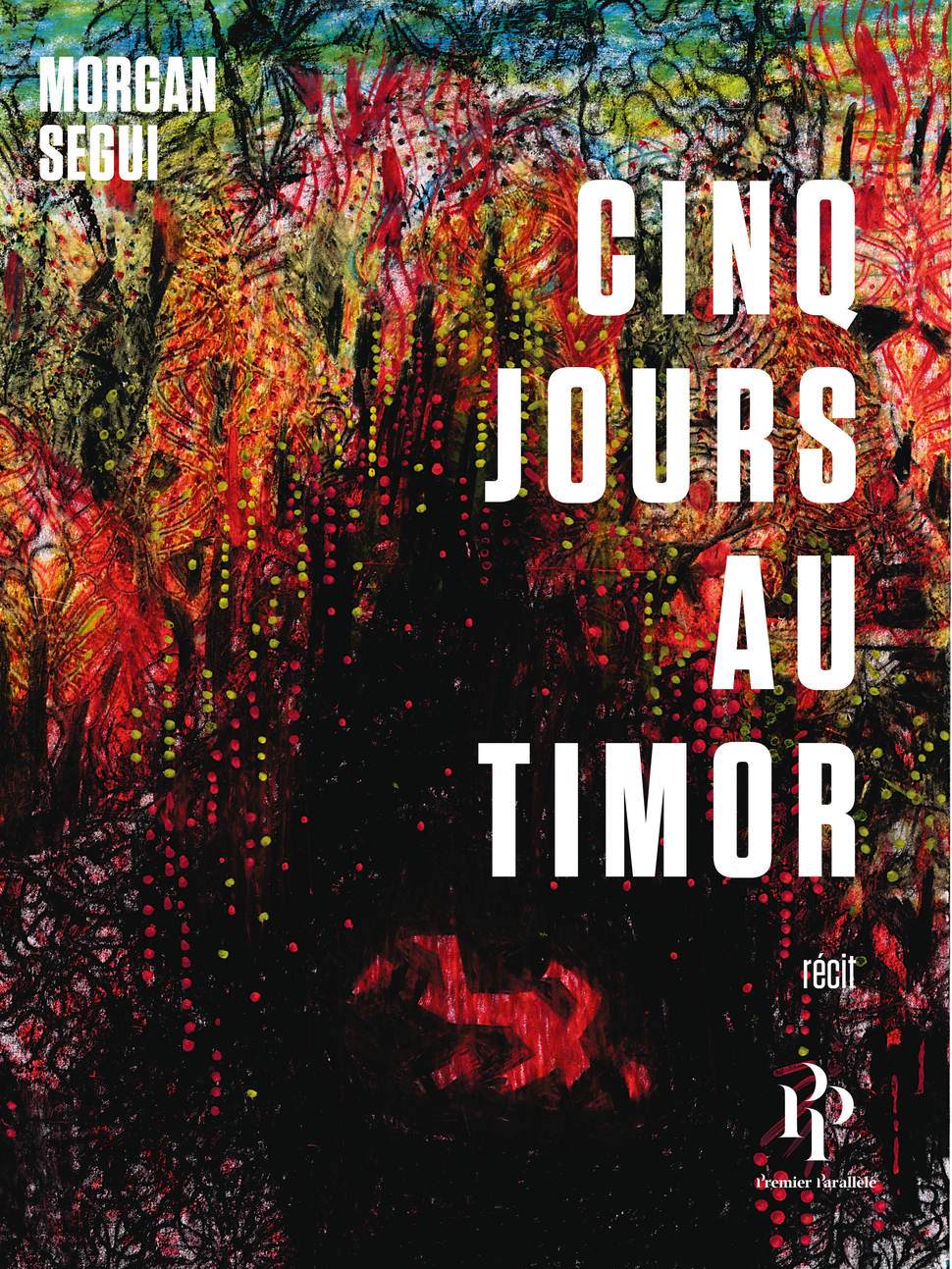







Premier Parallèle
Retrouvez-nous sur